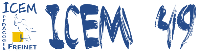

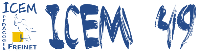

Christine nous emmène visiter sa classe du dehors. Nous passons d’abord en bord de Loire dans un espace aménagé municipal. Sa classe y a réalisé une étude du paysage : recherche sur le port de Varennes, sur le village. Elle y va chaque semaine avec une animatrice de la LPO. C’est à 3 km de l’école, cela prend parfois 1h30 car cela permet de multiples observations du paysage.
C’est un espace privé prêté, boisé.
Elle y va chaque semaine avec une animatrice de la LPO. C’est à 3 km de l’école, cela prend parfois 1h30 car cela permet de multiples observations du paysage.
C’est un espace privé prêté, boisé.
L’espace de la classe est délimité : il y a une "porte" et des limites définies. Le centre est "Quercus" un grand et vieux chêne, le maître des lieux.
Les élèves s’assoient en cercle pour débuter l’après-midi (sur des petits carrés de nappe). La séance commence par un temps calme : chaque enfant choisit un endroit et s’y installe.
Le programme de l’après-midi est défini, est présenté : les élèves ou l’animatrice proposent une ou plusieurs missions: aller voir les plantations, observer les traces, vérifier le pluviomètre. Puis il y a un temps calme: 10 minutes pour observer, écouter. Le temps libre est un moment essentiel: beaucoup de manipulation (creuser, couper), un espace bibliothèque est installé (référence de livres que transmettra Christine), un espace dessin, des loupes sont à disposition, réalisation d’une cabane collective.
Actuellement, un appareil photo a été installé pour "capturer" les animaux.
Ce projet avec la LPO s’arrête en décembre ; il aura duré 10 séances.
Christine et sa collègue souhaitent continuer en trouvant un lieu plus proche de l’école.
- dans la classe: on parvient à faire circuler les informations, à prendre des décisions avec toute une classe. Le conseil tient en cycle 3 même sans adulte quand c’est pratiqué depuis longtemps et quand l’institution est bien en place. En cycle 2 : rappel, problèmes, remerciements, projets. Les élèves s’en emparent-ils-elles vraiment?
- dans l’école : direction: charge qui pèse, adjoint.e se repose, s’appuie, ça ne s’arrête jamais, c’est lourd. Comment dire stop tout seul.e? l’équipe, la réflexion de groupe pourrait permettre de poser des limites ? Une équipe doit décider mais un.e seul.e est responsable, ça rend la position difficile, ça met la pression sur une personne. Comment définir les rôles des adjoint.e.s? La personne au poste de direction a du temps et petit à petit prend toutes les taches.
Découvrir tous et tout.e.s.
injonctions permanentes, comment trier, hiérarchiser, quelle prise de recul, temporiser?
Une organisation matérielle visuelle pour amener à une autonomie et un remplacement des adjoint.e.s pourrait être pensée par l’équipe pour alléger.
L’information : qui la détient? Quelle démocratie? L’administration a des injonctions : la personne au poste de direction ne doit pas transmettre les identifiants à ses adjoint.e.s.
Quelle démocratie? L’administration a des injonctions : la personne au poste de direction ne doit pas transmettre les identifiants à ses adjoint.e.s.
Rétro planning "film annuel des directeurs d'école" sur éduscol
-Canapé en palette avec des PS2: les enfants scient, pointent, Jérôme visse.
- asso : coop OCCE? USEP? Projet OCCE intéressant mais ce serait compliqué? Il y a de la compta à faire, on est mandataire, on peut être aidé. USEP est plus cher, il faut créer une asso.

Le premier objectif de la réunion de classe est d’abord de faire fonctionner la classe au quotidien, de réguler.
En cycle 1, c’est difficile d’en faire un outil de régulation. Il est important quand même pour semer des petites graines; privilégier les messages clairs pour apprendre à se parler, à s’écouter. En maternelle, le préalable, c’est d’amener les enfants à se parler entre eux.
Lors des premiers conseils, l'utilisation d'un bâton de parole peut inciter les enfants à prendre la parole en donnant leur avis sur ce qui s’est bien passé ou mal passé dans la semaine. Puis les règles sont introduites petit à petit.
Témoignage:
En PS-MS, conseil tous les 2 jours mais moment pénible et pas constructif.
Ex.: Problème de bruit dans la dînette, c’est l’adulte qui amène le problème pas de solutions proposées par les élèves. Les propositions venaient plutôt au Quoi de neuf? Les conflits sont réglés au fur et à mesure. Donc conseil est peu intéressant.
En cycle 2, ce n’est pas toujours très régulateur mais il est important de montrer que l’on peut y prendre des décisions, la partie remerciement est positive pour l'ambiance de classe.
L'inscription au conseil pose parfois problème: si l'enfant s'inscrit le jour même cela ne permet pas de différer et parfois d’apaiser le conflit. Attention à ce que le conseil ne devienne pas un règlement de compte.
En cycle 3 : réclamé par les élèves, régulateur.
Au sein de l'école: possibilité d'organiser un conseil interclasses ou même d'école!
2.Quand?A la fin de la semaine, avec la fatigue, les conflits peuvent prendre une part plus importante dans le conseil.
Certains ont testé à d'autres moments dans la semaine, voir le faire en 2 fois.
L’habitude permet de faire évoluer les pratiques.

Critiques, problèmes
Nommer ou non la personne? Tout le monde sait de qui on parle mais c'est le problème qui est traité.
Quand il y a une critique : la personne peut répondre ou non, propose ou non une solution.
La deuxième fois qu'il y a une critique sur le même problème, le groupe intervient pour aider à la prise de décision.
Remerciements félicitation
Faut-il les limiter pour ne remercier et féliciter que l'exceptionnel? Ou bien laisser les enfants remercier leurs copains mais cela alourdit ce moment.Nommer l'élève est important.
Propositions, projets
Toujours les mêmes? Et si ça ne me convient pas, si c’est trop récurrent, l’enseignant.e s’autorise-t-iel à dire son avis?
Mais peuvent-ils faire de nouvelles propositions de sortie s'ils ou elles ne connaissent pas?
L'argent
Combien coûtent les projets, d’où vient l’argent?
Ex: Collecte de papier (100 euros par mois), photographies scolaires...
Durée
Elle est variable en fonction de l'âge, de la fréquence des conseils et on peut limiter le temps de chaque rubrique.
Rôles
Secrétaire, animateur/animatrice, gardien du temps, bilan
Prise de note
Sur tous les sujets?
Par qui : enfant ou adulte ?
Sur un cahier / sur un tableau (visuel)
Lorsque des décisions sont prises, elles sont notées et rappelées au conseil suivant.